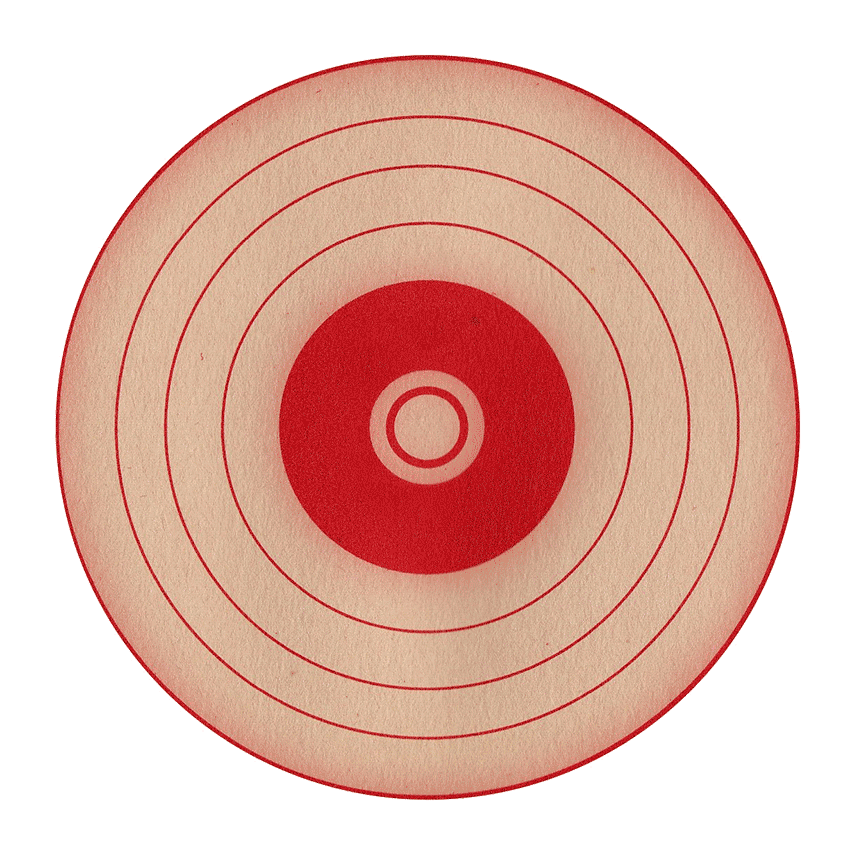Les films de Jean-Louis
Repérages #10
Repérages #10
Une promenade au Petit Maroc comme pour boucler une boucle. Le texte qui suit a été publié dans la revue « Kôan » N° 4 à été 2015 sous le titre « Le sultan Guichaoua et son chalutier violet ». Il se trouve que l’idée de filmer ce quartier a accompagné l’écriture de ce texte avant, pendant et après ; nous avons trouvé pertinent de le placer ici entre les promenades devenues des repérages et les premiers jours de tournages.
« Le petit Guy Trigodet arrive plus souvent que les autres en retard à l’école Carnot : la maîtresse l’interroge : « Mais madame le pont était fermé ! » Et oui le pont était souvent fermé au moment d’aller à l’école ! Ce témoignage très vivace vient d’un monsieur d’âge respectable. Derrière son regard malicieux on sent revivre cette anecdote bien réelle, augmentée par la pointe de fierté qui trouve là l’occasion de se manifester, d’appartenir à ce lieu « à part » et singulier. En haut de la butte, le clocher d’une vieille église servait d’amer aux navigateurs. La girouette de ce clocher avait ceci de particulier qu’au lieu du coq habituel elle représentait curieusement une main : « la main du bon accueil ». Une bourgade de lamaneurs ou pilotes avec leurs yoles qui se chargeaient de bien guider les gros navires à travers les dédales du chenal. Le vieux Saint-Nazaire, le site historique, était un simple quartier construit sur une butte avec son fort et son église depuis disparue.
Ce territoire, cerné par l’eau de l’estuaire pour une bonne part et entouré d’écluses est, de fait, une île. Pour les autochtones puristes, une des expressions désignant l’action « d’aller en ville » avait pour petite connotation « aller sur le continent ».
Des murailles sombres bâties sur les rochers, une vieille auberge à l’enseigne « la Boule d’argent », la boutique du maître ferblantier Noireau, quatre rues pavées pittoresques, et même « l’Auberge du roi de Suède », il est difficile à partir de l’aspect de ce quartier tel qu’il se présente aujourd’hui d’imaginer la vie grouillante et populaire d’il y a moins d’un siècle, dans ses rues étroites, ses petits jardins abrités du vent, ses nombreux bistrots, sa boulangerie, les petits jardins derrière la plupart des maisons avec les clapiers à lapins ou des poulaillers. Ainsi pour mieux cerner l’esprit de ce lieu mieux vaut interroger les personnes qui y ont vécu autrefois. Les témoins actuels furent des pêcheurs pour la plupart. Ils se souviennent et racontent volontiers leur enfance et leurs exploits pour certains. Leurs parents venaient du Finistère, Douarnenez, Le Guilvinec, d’autres de l’île de Noirmoutier, les boucautiers par exemple, et ce depuis le milieu du dix-neuvième siècle.
Nombreux commerces ont leur devanture sur la rue principale et d’autres sur la place ; n’oublions pas de citer la boucherie-charcuterie du Finistère, ni surtout l’épicerie servant aussi de bar aux senteurs d’épices de la mère Toussaint qui vendait aussi la pâte pectorale, bonne pour les rhumes, et où, dans une ambiance haute en couleurs et en rires, tout se savait et s’échangeait. Pour les enfants qui venaient faire les courses il y avait des berlingots ou des sucettes. Il faut préciser qu’elle ne pouvait surveiller à la fois le bar et l’ensemble de l’épicerie, ce qui fait que parfois les anciens attablés au bar se servaient un verre en douce et lorsqu’elle surveillait le bar ce sont les enfants qui prenaient quelques bonbons ni vus ni connus. On imagine aisément la mère Toussaint sortant de sa cachette, l’air soupçonneux ; gageons que ces petits larcins n’ont jamais coulé la boutique. D’autres établissements avaient pour noms parlants : « A l’abri de la tempête » pour une buvette ou cette mystérieuse « L’Auberge du roi de Suède » devenue historique. Il y a longtemps sous la régence de Philippe d’Orléans suite à la conspiration de Pontcallec : le jeune marquis prit fait et cause pour les pauvres paysans qui l’entouraient en centre Bretagne, et fomenta une conspiration qui fut sévèrement réprimée. Le tribunal se réunit dans cette auberge pour interroger les habitants soupçonnés d’avoir participé à cette conspiration. Le marquis et trois de ses proches furent exécutés à Nantes.
Au café de Surate deux personnes conversent, plus précisément une personne raconte à l’autre une histoire, il y est question d’un certain Guerino qui, à la recherche de son père se rend à Norcia dans l’Apennin. Il gravit des roches terribles et parvient à une caverne. Dans cette caverne quatre chemins se séparent ; après avoir trouvé le bon chemin avec une chandelle il arrive à une porte de métal. Sur chaque battant un démon peint paraît vivant et une inscription : « Qui entre par cette porte et ne sort pas au bout d’un an vivra jusqu’au jugement dernier, et alors sera damné. » Guérino frappe, et est admis auprès de la Sibylle. Elle lui montre son palais, ses trésors et son jardin pareil à un paradis. Sous le haut du ciel spirituel, regard dur et souffle marin, cités étrusques et bistros rongés de patine, il a dû dormir dans des hamacs ou dans des camps de fortune, plus souvent sur mer que sur terre et sur terre préférant les petites îles aux grands continents où il ne va guère plus loin que le port de ravitaillement.
Ardengo est d’une autre trempe, on ne le voit jamais se délasser ni même s’asseoir, flibustier, braconnier, trafiquant d’onyx, dur à cuire, il a toujours belle allure et fait détourner les regards des jeunes femmes et des moins jeunes tout en leur parlant de ses exploits aux Philippines, aux Moluques ou à Sumatra. Ardengo qui transportait du karafuu, des clous de girofles de contrebande pour le revendre à Mombasa a été plus qu’ému par cette princesse rebelle… Et à la minute même où elle a baissé ses longs cils recourbés il a changé du tout au tout. Il lui offre un petit anneau d’or, lui-même relié à une histoire des plus mystérieuses qu’il conservait en secret. Il vient de la conspiration de Pontcallec, étrange marquis sous la régence de Philippe d’Orléans dont il fut question plus haut. Au moment où il comprit qu’il était cerné, le marquis confia un anneau d’or à son aide de camp ; cet anneau passa de mains en mains pour arriver dans la poche à gousset d’Ardengo. Avec l’entrée de Nihasah dans son univers, Ardengo comprit qu’il fallait transmettre cet anneau, il choisit pour ce faire un soir d’orage et une crique sauvage.
Pour revenir à notre île, tout se trouvait sur place, il y avait également une mercerie et même un bijoutier. Le père Lardeau, rebouteux de son état, conjurait les feux et les verrues, « baissait les vers » des enfants et vendait des tisanes bizarres au coin de la rue de la vieille église. Les enfants jouaient aux billes pour les garçons, à la corde à sauter et à la marelle pour les filles. Et surtout les anciens se souviennent de l’expression « jouer sur le Fort » c’est-à-dire sur un chemin et un petit terrain vague à l’emplacement d’une batterie de canons, autrement appelé esplanade du vieux Fort, entouré de genets plus que drus. Ce fort connut des heures de gloire et le fantôme de Jean d’Ust vient le hanter de loin en loin. L’on retrouve Guy avec ses camarades qui improvisent une balançoire « tape-cul » avec les bois de Norvège des chantiers Hailaust et Gutzeit dans les senteurs du bois de pitchpin.
Une place de la Rampe d’un côté, un fort disparu quelque part au milieu, une usine élévatrice de l’autre côté, le promontoire originel semble avoir paradoxalement rétréci dans le temps ; « la forme d’une ville change plus vite, hélas que le cœur d’un mortel. » (1) Les bateaux de pêche étaient alors nombreux et s’amarraient au port sur trois rangées. Ils avaient pour noms : « la Petite Marcelle » ou « la Petite Josiane » ; « la Petite Mimi » ou encore « le Marc-Hélène ». Les gars revendaient ou donnaient à leurs amis une part de leur « godaille » selon l’abondance de la pêche. Ils sont tous heureux de revenir au port, fiers de vivre sur une île et ils le disent. Fierté enfin d’une bonne pêche et plaisir d’offrir.
Deux bateaux, « Le Pélican » d’Henri Lagré et « Le Sirocco » d’André Trimaud, tous deux venus de La Turballe, furent les premiers à se lancer dans la pêche à la langoustine dès 1955. Plusieurs chalutiers de l’Isle d’Yeu et des bateaux de Noirmoutier venaient débarquer leur pêche à la criée pendant l’hiver. La quasi-totalité des thoniers de l’Isle d’Yeu y débarquaient leurs thons jusqu’au début des années soixante. Les chaluts étaient en chanvre et il fallait régulièrement les passer au « cachou », produit gras de couleur réglisse, dans une sorte de grande marmite puis les faire sécher. Le cachou est une substance extraite d’un bois d’acacia d’Inde également employé en tannerie. On amarrait avec la bosse, on dégageait les poissons restés accrochés au filet avec un « baz croc ». Jean Guichaoua, le sultan des fêtes, possédait un chalutier nommé « Dalc’h mad » c’est-à-dire « le tient bon ».
Avant 1900 des tonnes de sardines étaient pêchées sur les côtes. Beaucoup moins par la suite. Les grands bancs de poissons, que ramenait immuablement le rythme des saisons, ont pratiquement déserté les côtes bretonnes. Les principaux ports à sardines étaient Douarnenez ou Le Guilvinec, et des usines à sardines s’égrenaient le long de la côte, employant principalement des femmes. Au plus fort de l’activité portuaire on appelait « Marocains » les Bretons, pêcheurs de sardines qui allaient parfois jusqu’aux côtes du Maroc, d’où le surnom qui est resté. Une fois, le roi du Maroc est venu accoster dans le port et les plus hardis des marins ont raconté à son équipage comment le quartier, l’île, s’était baptisé le Petit Maroc. Peu de temps après le roi fit envoyer des djellabas et des chéchias aux habitants en signe d’amitié. L’origine de cette appellation est probablement plus ancienne car il existe d’autres lieux dits war roc’h en breton, plus précisément Ti war roc’h ; la traduction approximative est : "maison/habitation sur le rocher" et si on prononce à la française et phonétiquement cela donne quelque chose comme : « ti mar roc ».
Le fameux bac de Mindin permettant de traverser plusieurs fois par jour l’Estuaire bien avant la construction du pont était une attraction en soi. Le sentiment de vivre sur une île était très présent, l’activité du port impliquant régulièrement la fermeture d’un pont. Rue de l’Ecluse, les bruits du port, les mouettes, le vent. Place de la Rampe, des murets moussus d’où dépassent des lilas et des giroflées ; on croise des femmes avec la coiffe bigoudène, haut tube de dentelles dans lequel on aurait pu facilement dissimuler une chopine de vin. Dans les rues, des femmes avec la fameuse coiffe luttent contre le vent. Les mâtures légères des bigoudènes naviguent au milieu des voilures déployées des coiffes du pays d’Auray, tandis qu’à côté passent des hommes aux vareuses délavées et aux vastes bérets, qui font sonner leurs sabots sur le pavé. Pas question pour les habitants de brader leur identité ni leur insularité. Ces pêcheurs dits « Bas bretons » ont su conserver, mieux que les populations issues de l’exode rural, leur langue, leurs costumes, leurs coutumes, leur profession même. Ils promènent sur leurs solides épaules des avirons ou des filets, ou bien ils portent des paniers pleins de poissons brillants. Leur « canote » n’est jamais bien loin de là et leur démarche garde encore le mouvement chaloupé de la houle.
Au café avec vue sur le port il se passe toujours quelque chose et le soir il n’est pas rare que l’accordéon soit de sortie. Revenir à la maison, retrouver les amis au café, refaire le parcours, attendre ceux qui ne sont pas encore arrivés et ainsi de suite. Les hommes ont chacun une place attitrée dans le café et les places se réorganisent spontanément quand les uns ou les autres font leur entrée ou leur sortie. Chaleur et mise en scène au milieu des plaisanteries calamiteuses. Les hommes savent aussi se taire lorsque passe un ange blessé ou simplement mouillé. La guerre 39-45 a tout détruit. Comment une petite partie de l’esprit du lieu a-t-elle subsisté ? On ne sait, les urbanistes et architectes ont fait ce qu’ils ont pu, laissons leur ce bénéfice du doute. Ni église, ni Fort, ni aucune maison qui tienne debout n’a subsisté. Le sultan Guichaoua et son chalutier violet, l’esprit du lieu, plane peut-être au-dessus du Fort invisible. »
(1) Charles Baudelaire « Le cygne »